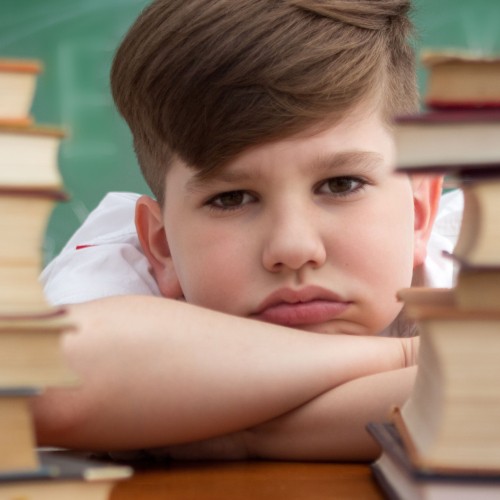
Difficulté scolaire : Frustration - pouvoir d’apprendre et peur de l’imaginaire
"Je vous propose ici une approche originale de la difficulté scolaire pour des élèves que la pédagogie différenciée classique n’aide pas. Ces enfants n’échouent pas par manque de moyens techniques, mais parce qu’apprendre menace l’équilibre psychique qu’ils ont construit."
- Hervé RANVILLE, conseiller pédagogique et référent CSE et Sciences chez ForProf.
L’approche de Serge BOIMARE ?
Serge Boimare (un enseignant - psycho pédagogue - directeur de CMPP - formateur qui accompagne des équipes pédagogiques ) Propose une approche vraiment originale de la difficulté scolaire , tout à fait en prise avec les élèves que l’on rencontre aujourd’hui et les situations de classe qui y sont associées.
Il propose de faire la différence entre :
- les élèves qui sont en difficultés par défaut d'aménagements techniques, rythmes, aide… qui relèvent de la pédagogie différenciée ordinaire et de ses dispositifs de remédiation.
Et ceux qui font l’objet de cette présentation – pour lesquels toutes ces techniques pédagogiques s’avèrent relativement inefficaces.
- Des élèves qui font tout pour ne pas apprendre, même s'ils prétendent le contraire, parce que les contraintes de l'apprentissage remettent en cause l'équilibre qu'ils se sont construit depuis le plus jeune âge, et qui pour des raisons socioculturelles ou socio-familiales ne peuvent remettre en cause des limitations souvent liés à la représentation de soi, des autres et de l’entrée dans le monde des connaissances explicites. À long terme ces défaillances dans les relations aux apprentissages vont causer une carence dans la capacité même à apprendre avec des conséquences instrumentales importantes.
Des facteurs semblent essentiels :
- l’insuffisance d’une initiation précoce à la frustration (qui est à la source des compétences psychiques liées à l’apprentissage)
- un monde intérieur pauvre voir chaotique où le langage n’arrive pas à être l’outil de gestion de la pensée et de l’action nécessaire à l’apprentissage en raison d’interaction langagières précoces insuffisantes ou d’un vécu traumatique.
Apprendre peut faire peur
- Les enfants qui ne jouent pas, qui ne font pas semblant, qui sont dans l’inhibition témoignent souvent de difficultés de symbolisation, car ils utilisent peu le langage et la pensée intérieure pour se projeter dans la réalité et l’anticiper.
- Les enfants qui n’apprennent que dans l’action, qui ne veulent agir que sur la réalité, expriment aussi une difficulté à utiliser le savoir et le langage comme représentant de la réalité et comme outils d’aide à l’action.
Cette difficulté à entrer dans le langage (= à symboliser) vient le plus souvent signifier des craintes plus que des problèmes de compétences.
L’idée qu’apprendre puisse faire peur est originale et déstabilise les représentations habituelles de l’apprentissage, mais c’est une approche fructueuse à travailler.
Peur d’apprendre, peur de savoir et peur de la pensée imaginaire :
Vous allez facilement repérer ces trois éléments impliqués dans les problématiques des élèves. Ils permettent de se repérer globalement, même si certains enfants ont des positions intermédiaires, ou jouent sur plusieurs registres.
L’élément commun de ces enfants, c'est la peur du changement, l’élément commun des démarches de remédiation sera de sécuriser d’abord puis d’aider à mieux symboliser et à penser l’apprentissage.
I- La peur de savoir :
C’est la peur de l’efficacité, du pouvoir que donne la manipulation des idées, c’est une peur de maitriser les connaissances.
Elle est souvent due à des messages implicites contradictoires de l’environnement (réels ou imaginés par l’enfant) du type : “apprend mais ne connais pas, mais ne dépasse pas tes parents, mais ne découvre pas ce qu’on te cache face à des non-dits familiaux- ou des réalités évidentes dont personne ne parle, travaille mais ne prend pas le risque de l’action etc ».
L’imaginaire et la pensée vont leur faire peur, car c’est une nouveauté permanente, alors que la réalité matérielle ne change pas beaucoup.
Comment sont-ils ?
Ils sont plutôt conformistes, inhibés, ne créent pas de liens logiques, et s’installent souvent dans une soumission apparente et un certain défaitisme. Fatigués, ils manquent souvent d’ intérêt pour les cours. Ils ont parfois très peur de ce qu’ils pourraient imaginer : la peur de se formuler l’avenir est un frein majeur au développement des activités mentales symboliques de ces enfants.
Ils mettent en œuvre de véritables stratégies anti-pensée :
- imaginer les règles plus strictes qu’elles ne sont pour se justifier,
- refus de faire les efforts qu’il faut à un moment clef de l’apprentissage, alors qu’ils y sont presque arrivés,
- se plaindre qu’on les oblige à penser et à symboliser (« ça ne sert à rien, ce n’est pas concret »),
- se balancer, s’ennuyer, se passionner pour les activités non-symboliques (jeux vidéo, taille de bois, dessins symboliques qui finissent en griffonnage).
Que faire ?
Ces enfants ont d’abord besoin d’un cadre de sécurité à toute épreuve pour progresser : pour leur permettre dépasser ces inhibitions, on travaille à la fois ;
- des activités sur la réalité, pour qu’ils découvrent que plus de représentation du monde c’est plus de contrôle et moins de peur, (démarche en sciences -> de l’action / manipulation -> verbalisation structuration en notions).
- des activités sur l’imaginaire, plus de créativité c’est plus de solutions pour l’avenir, donc c’est plus de contrôle et moins de peur pour leur permettre d’exprimer et de symboliser un imaginaire potentiellement menaçant (transférer ->dessiner ce qu’on a lu – raconter un dessin -> imaginer ce qui s’est passé avant / ce qui se passera ensuite – comment ça a commencé / comment ça va finir -> dessiner le début / la fin.
On va les conduire du concret et du réel vers la pensée et à l’imaginaire, d’un noyau de connaissance vers une expansion, on va développer visuellement des réseaux et des arbres de connaissances en faisant percevoir que chaque acquisition se fonde sur un socle solide et rassurant.
II- La peur d'apprendre :
C'est la peur de devoir faire l’effort d’abandonner la magie et la toute-puissance enfantine. Ils veulent tout savoir, tout de suite, mais sans apprendre car apprendre les oblige à se structurer.
Penser est différent de rêver car penser demande une confrontation au négatif (choix, élaboration, discussion intérieure).
Elle peut se fonder sur le plaisir qu’a l’enfant à fasciner ses parents et sur l’idée qu’il n’y a pas de limite – surtout si les éducateurs hésitent (culpabilisent) à les poser.
Les référents de ces enfants n’ont pas forcement conscience de l’importance des attentes « éducatives et culturelles » liées par exemple au comportement, à l’acquisition d’un langage explicite dans la petite enfance et à des activités structurées et sociales.
Comment sont-ils ?
Hyperactifs et toniques, ils n’aiment ; ni être soumis aux règles, ni être jugés, ni remettre en cause les connaissances qu’ils ont déjà, ni tenir compte du temps (c’est tout de suite sinon j’abandonne). Ils sont dans l’action, agir, voir, s’imprègnent facilement de violence ou de sexuel, compte-tenu de l’imaginaire débordant dont ils font preuve, d’autant qu’ils pensent pouvoir réaliser ce qu’ils pensent sans efforts.
Pour eux c’est le chemin qui est difficile, compte tenu de la faible tolérance à l’incertitude et à la frustration dont ils témoignent.
Que faire ?
Mettre un cadre large qui limitera les débordements, et :
- travailler à symboliser les limites, en verbalisant les tentatives de transgressions dans un cadre très concret (terrain d’aventure, milieu naturel).
- puis introduire des limites plus strictes qui seront acceptée dans la mesure où la magie perdue leur donne un pouvoir réel sur les contenus (ex : proposer de nouveaux ateliers dans un parcours d’EPS en grande section -> partir de la fin d’une histoire pour inventer ce qui s’est passé avant oblige à prendre en compte des contraintes de causalité / de temps ).
Il a besoin de temps individuels d’accompagnements dans la classe, pour l’amener à accepter le cheminement proposé collectivement.
Les activités sur la réalité lui sont proposées dans la forme inverse : anticipation, analyse de l’anticipation pour voir ce qu’elle nécessite, retour au quotidien pour voir si les germes de l’anticipation s’y trouvent, analyse des savoirs actuels et ensuite retour sur les modes d’acquisitions passés.
- on va le conduire à l’intérieur d’un cadre, depuis son imaginaire jusqu’à une représentation active du réel.
III- La peur du contenu imaginaire :
Des enfants ont très peur de leur imaginaire, voire de l’imaginaire familial. Cette peur est une limite importante au développement des facultés de représentation. Les images potentielles, souvent chargés d’angoisse font peur, et sans mots pour les dire, elles ne s’exprimeront pas et feront obstacle à l’acquisition des connaissances.
Cette peur se fonde souvent sur une histoire personnelle ou familiale douloureuse, voire traumatique, où la violence a une place centrale, qu’elle soit intra-familiale (10% des enfants y sont exposés), liées aux conditions de vie (25 % des enfants sont en situation précaire) ou aux conditions d’une migration traumatique (1/1000 élèves mais concentrés dans les mêmes secteurs géographiques).
L’enfant pense donc que s’il évite de symboliser il évitera l’angoisse “pas de mot = pas de peur“ (ce qui est erroné) d’où un ralentissement parfois important de la pensée.
Les activités sur l’imaginaire seront une tentative de travailler sur ce niveau.
“ Entre leur sous-sol de leur histoire personnelle et le premier étage des apprentissages, il manque un rez-de-chaussée avec porte d’entrée pour qu’ils relient leur imaginaire particulier au général culturel de l’espace social“
Que faire ?
L’objectif est de symboliser les images internes en mettant des mots sur de l’implicite, pas d’interpréter pour utiliser le rôle constructif de l’imaginaire sur le réel.
Les textes mythologiques et des origines sont les récits du monde qui mettent l’enfant en relation avec des références culturelles sociales. Leurs contenus, des contes traditionnels parfois violents, sont au niveau de ce qui peut gêner la pensée des enfants. Ils résonnent avec les peurs qui meublent l’imaginaire des enfants ; rois, reines, princes, guerres, déplacements de populations, meurtres, parricides, incestes, émasculation, enlèvements, errances, sang, larmes, sexe, orphelins... (cf Œdipe ou Orphée aux enfers).
Les émotions et les passions qui s’expriment clairement sont suivies d’actions fortes, (on ne tergiverse guère dans les mythes).
Cela contribue à aider l’enfant apprivoiser son imaginaire sans trop de danger, puisque d’autres l’ont fait avant lui sur des sujets parfois bien plus terribles ! L’horreur de certains mythes banalise les imaginaires menaçants et médiatise les réalités douloureuses vécues par certains enfants
Cf la fiche outils ici
- Hervé RANVILLE, conseiller pédagogique et référent CSE et Sciences chez ForProf.
_________________________________________________________
Pour approfondir l’approche de S.Boimare :
- Podcast https://www.youtube.com/watch?v=v4SgqLySljQ
- Ouvrage L'Enfant et la Peur d'apprendre . S.Boimare, Dunod, 03/2000 . - ISBN 2-10-004666-7